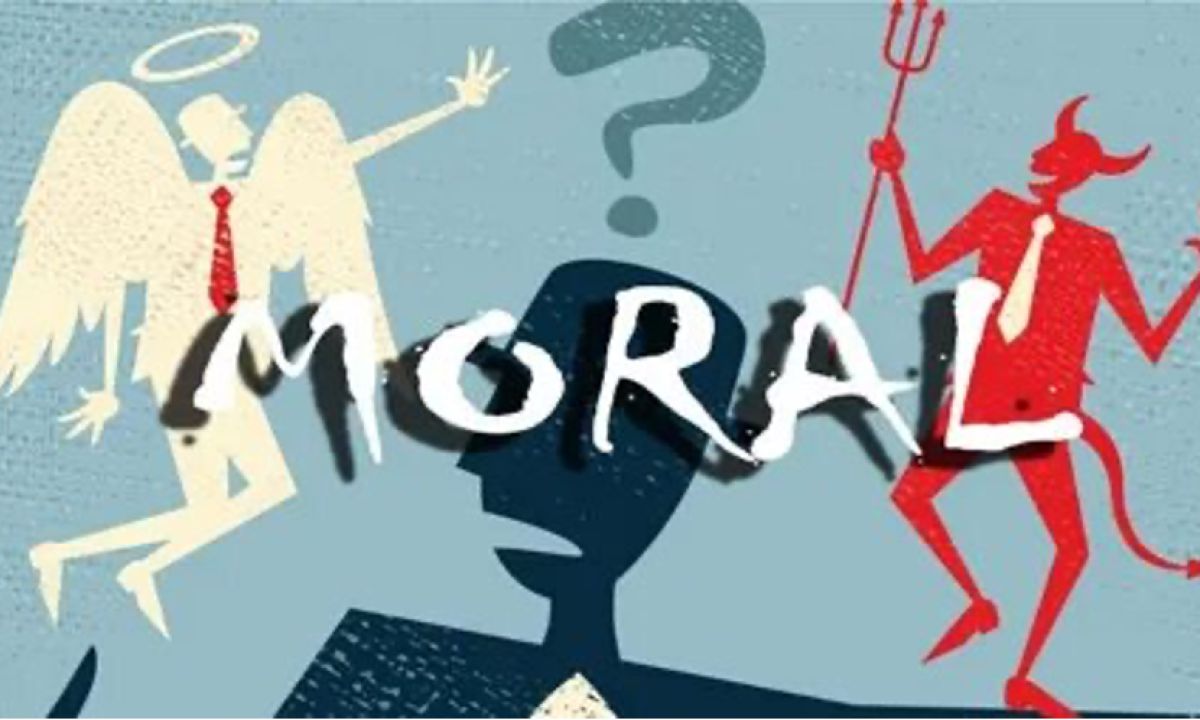
Géopolitique et moralité
Au sein de nombreux cercles politiques occidentaux, le terme « géopolitique » a une mauvaise connotation. Le mot « géopolitique » évoque des images de manœuvres impériales, de réalisme cynique et de force brute. Dans le discours politique, particulièrement en Europe et aux États-Unis, la « géopolitique » est le fait de l'adversaire. C'est un terme réservé aux ambitions de la Russie, à la nouvelle route de la soie de la Chine, ou à l'influence régionale de l'Iran. L'Occident, selon le récit conventionnel, ne joue pas à de tels jeux. L'Occident agit non par intérêt personnel mais par principe, non par soif de pouvoir mais par sens du devoir de défendre la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'Occident libère — il ne conquiert pas. L'Occident défend — il ne provoque pas. L'Occident se range du côté de la moralité, tandis que ses adversaires sont animés par la soif de pouvoir, l'ambition territoriale et l'esprit de revanche. L'Occident est idéaliste et guidé par des valeurs, tandis que ses adversaires sont obsédés par le calcul géopolitique.
Cette dichotomie est sans aucun doute très flatteuse pour l'amour-propre de nombreux citoyens en Europe et en Amérique, qui sont également profondément convaincus que l'Occident se trouve désormais fermement du côté du bien. Cependant, une telle vision du monde n'est pas seulement trompeuse, elle est carrément dangereuse. Elle favorise la complaisance morale dans les sociétés occidentales et un orgueil démesuré dans la politique occidentale. Elle aveugle les sociétés face aux forces structurelles et aux intérêts stratégiques qui motivent leurs propres gouvernements. Surtout, elle porte le risque d'escalade de conflits tels que la guerre en Ukraine, qui aurait facilement pu être évitée avec moins d'arrogance et plus d'honnêteté.

La géopolitique a émergé comme discipline théorique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle comme une tentative d'analyser et d'expliquer les rapports de force entre États à la lumière des conditions géographiques. Les premiers théoriciens influents tels que Friedrich Ratzel en Allemagne et Halford Mackinder en Grande-Bretagne ont jeté les bases d'une approche qui considérait l'influence politique, la répartition des ressources et le contrôle territorial comme comme étroitement liés à l'espace et au territoire. La géopolitique se concevait comme une science permettant de penser stratégiquement l'espace dans laquelle l'histoire, la géographie et le pouvoir étatique étaient entremêlés. Dans les années 1930 et 1940, cependant, cette façon de penser fut exploitée par l'idéologie nazie. Karl Haushofer, un partisan clé de ce qu'on appelait la « géopolitique allemande », fournit avec ses concepts d'une « Grande Allemagne » et d'« espace vital » une justification pseudo-scientifique à l'expansion, à la guerre et à la domination. Après la Seconde Guerre mondiale, le terme « géopolitique » fut donc longtemps regardé avec méfiance et largement évité dans une grande partie de l'Europe.
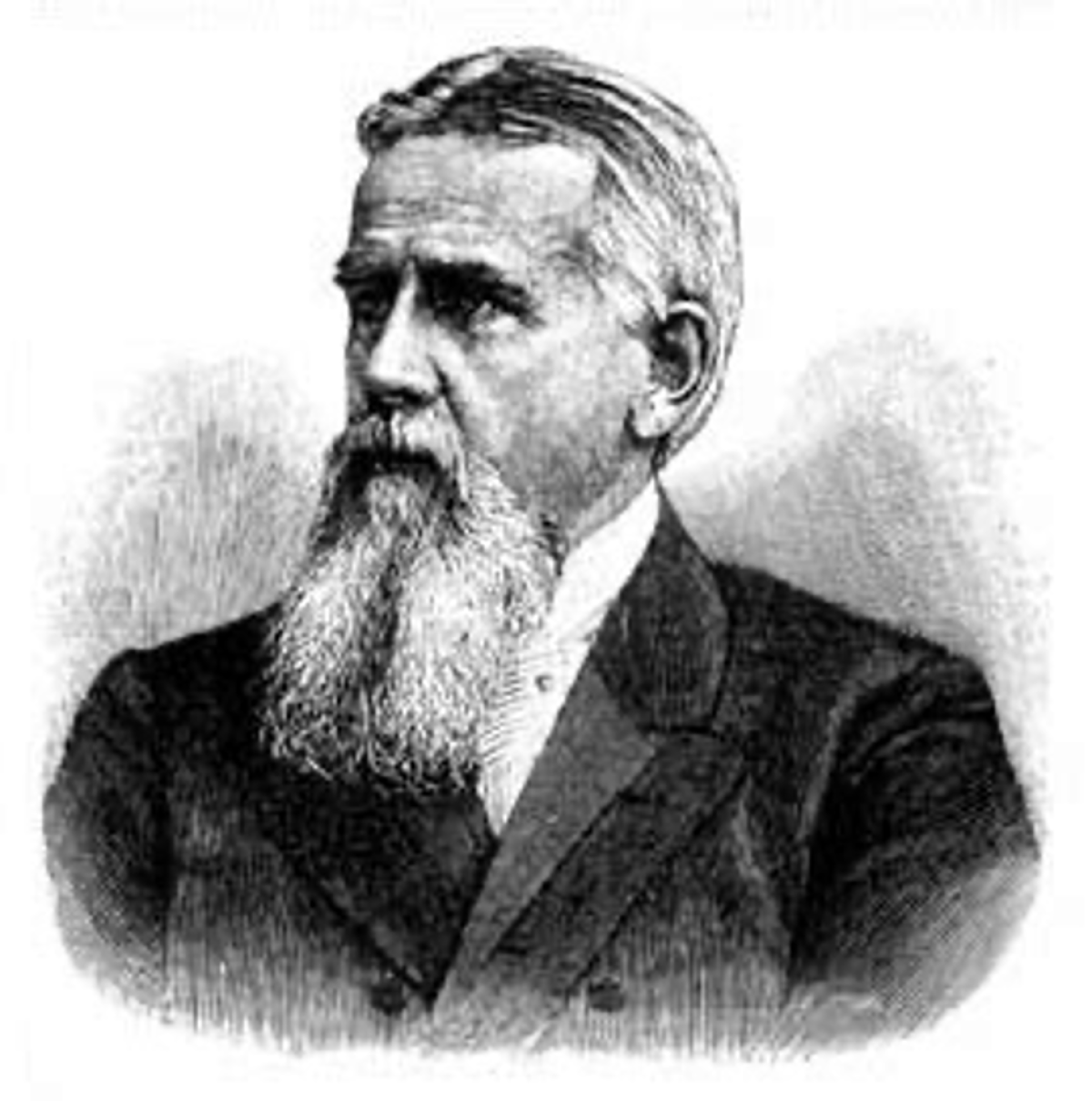
Malgré cet héritage historique, la logique géopolitique n'a jamais complètement disparu de la scène internationale. Même en Occident, qui proclame ouvertement les droits de l'homme, les valeurs libérales et les principes multilatéraux, la pensée géopolitique est en réalité bien vivante. Les pays occidentaux poursuivent des intérêts stratégiques, sécurisent des voies maritimes, des sources d'énergie et des sphères d'influence, construisent des bases militaires le long des routes commerciales clés, et agissent de manière ciblée pour contenir les puissances émergentes comme la Chine et la Russie. Même les interventions humanitaires, les alliances diplomatiques et les sanctions ne peuvent souvent pas être comprises sans un éclairage géopolitique. Alors que la rhétorique a changé, le calcul géopolitique demeure une constante silencieuse dans la politique étrangère des démocraties occidentales.
L'alibi moral de l'Occident
Le récit moral occidental a atteint son apogée avec la guerre en Ukraine. Dès les premiers jours de l'invasion russe en février 2022, les médias et les élites politiques d'Europe et d'Amérique du Nord ont présenté le conflit en termes quasi bibliques : la Russie comme l'éternel agresseur, l'Ukraine comme la victime innocente, et l'Occident comme le protecteur vertueux de l'ordre international. Ce récit a permis une mobilisation extraordinaire de l'opinion publique, de l'aide militaire et des sanctions économiques. Mais il a aussi étouffé tout débat. Toute suggestion selon laquelle l'expansion de l'OTAN aurait pu contribuer à la crise, toute proposition de négociations ou de concessions à Moscou, était taxée d'apaisement, de trahison, voire de haute trahison.
Les demandes russes avant la guerre n'étaient pas de nature impériale. Moscou n'exigeait pas le démantèlement de l'Ukraine, ni n'insistait pour installer un régime fantoche à Kiev. La demande centrale était que l'Ukraine reste neutre — spécifiquement, qu'elle ne rejoigne pas l'OTAN. Que l'on soit d'accord avec cette demande ou non, elle n'était ni irrationnelle ni sans précédent. Elle reflétait la préoccupation stratégique de longue date d'une grande puissance qui se sentait menacée par l'encerclement. Les États-Unis ne toléreraient pas de bases militaires chinoises au Mexique ; la Russie n'accepterait pas de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce n'était pas une question de moralité — c'était une question de logique sécuritaire classique. Mais l'Occident ne voulait pas en entendre parler.
Ce qui est remarquable, ce n'est pas que la Russie ait formulé cette demande, mais que l'Occident l'ait rejetée avec tant de fierté, même si cela signifiait sacrifier l'Ukraine. Pour reprendre les mots de Wendy Sherman, qui était secrétaire d'État adjointe des États-Unis en 2021 :
"Les États-Unis ne permettraient à personne de fermer brutalement la porte ouverte de l'OTAN. Nous avons été clairs : nous ne prenons pas de décisions pour d'autres pays. Nous n'accepterons pas qu'un pays ait un droit de veto sur un autre pays en ce qui concerne l'adhésion à l'alliance de l'OTAN."
Wendy Sherman
Ou, pour reprendre les mots de l'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg dans son rapport à un comité de l'Union européenne en septembre 2023, lorsqu'il évoquait l'offre de la Russie à l'OTAN avant la guerre :
“Le contexte, c'est qu'à l'automne 2021, le président Poutine a déclaré et envoyé un projet de traité que l'OTAN était censée signer pour promettre qu'il n'y aurait pas d'expansion supplémentaire de l'OTAN. C'est ce qu'il nous a envoyé. Et c'était une condition préalable pour ne pas envahir l'Ukraine. Bien sûr, nous ne l'avons pas signé.”
Jens Stoltenberg
Le principe de la souveraineté ukrainienne — y compris le droit hypothétique d'adhérer à l'OTAN — était traité comme sacré, même si le respect de ce principe signifiait la guerre. Dans cette optique, le droit moral abstrait de l'Ukraine l'emportait sur les risques concrets de conflit militaire, de dévastation économique et de dizaines de milliers de morts.
Ce n'est pas de la moralité. C'est de l'absolutisme moral — une position rigide et idéologique qui ignore les conséquences au profit du dogme. C'est l'exact opposé de la prudence, qui est une vertu cardinale dans toute tradition éthique et politique sérieuse.
La realpolitik sous couvert de morale
Qualifier cette attitude de « morale » revient à ne pas saisir le rôle de la moralité en politique. En réalité, la moralité dans les relations internationales est relative, conditionnelle et stratégique. Elle est invoquée quand elle est utile et ignorée quand elle dérange. Les États-Unis et l'Europe défendent les droits de l'homme en Iran, mais les ignorent en Arabie saoudite. Ils critiquent l'autoritarisme chinois, mais cherchent à augmenter leurs exportations vers la Chine. Ils condamnent les crimes de guerre commis par la Russie, mais restent silencieux sur les victimes civiles des opérations de l'OTAN en Libye ou des frappes de drones américains au Pakistan.
Ce deux poids, deux mesures n'est pas un hasard. Il reflète des intérêts, non des valeurs. L'Occident n'invoque pas la moralité pour se guider, mais pour justifier ses actions — pour légitimer le pouvoir sous couvert de principes. En bref, c'est de la realpolitik sous couvert de morale.
La tradition de la realpolitik — rendue célèbre par Machiavel et Bismarck — partait du principe que les États agissent selon leurs propres intérêts en matière de sécurité et de pouvoir. La moralité n'intervient que si elle sert ces objectifs. Cette tradition était dure mais honnête. La version occidentale d'aujourd'hui est plus dangereuse parce qu'elle est malhonnête. Elle refuse de reconnaître qu'elle aussi poursuit des intérêts — que l'Occident est également un acteur géopolitique.
Prenons l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Elle a été vendue comme une croisade morale contre la tyrannie et les armes de destruction massive. En réalité, c'était une manœuvre stratégique pour remodeler le Moyen-Orient. La guerre a causé des centaines de milliers de morts, déstabilisé la région et conduit à l'émergence de Daech. Pourtant, pratiquement aucun politicien occidental n'a eu à en assumer la responsabilité. Personne ne s'en est excusé. Les États-Unis et les autres pays de la coalition n'ont pas versé de réparations à l'Irak. Pourquoi ? Parce que le public américain et européen était bien trop disposé à accepter l'alibi moral. La guerre d'Irak a peut-être été une erreur tragique qui a directement causé la mort de centaines de milliers de personnes, mais nous restons les gentils, ou du moins c'est ce que semblait être le raisonnement. Qui se soucie de quelques musulmans arriérés ?
Ou prenons le cas de la Libye en 2011. L'OTAN est intervenue pour prévenir un prétendu génocide à Benghazi. Le véritable objectif était de provoquer un changement de régime. Le résultat fut l'effondrement de l'État, la guerre civile et une crise migratoire qui continue de peser sur l'Europe. Ici aussi, l'intervention était justifiée au nom des droits de l'homme — mais ses conséquences furent tout sauf humaines.
Le culte de la vertu et la suppression de la complexité
L’un des traits les plus inquiétants du discours moral occidental est sa simplification à outrance de la complexité. Au nom d’une supposée clarté morale, toute nuance est effacée. Les conflits deviennent des pièces morales : le bien contre le mal, la liberté contre la tyrannie. Cette représentation manichéenne est intellectuellement paresseuse et politiquement irresponsable.
La guerre en Ukraine en est un exemple parfait. Dès le début, les sociétés occidentales ont été incitées à considérer le conflit comme un cas évident opposant agression et résistance. Il n'y avait pas de place pour une discussion sur l'histoire de l'expansion de l'OTAN, le rôle du soulèvement de Maïdan en 2014, ou le sort de la population russophone du Donbass. Quiconque soulevait de telles questions était rapidement qualifié de « sympathisant de Poutine » et ses arguments étaient écartés comme non pertinents au mieux, insensés au pire.
Mais l'histoire de la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022. Les germes de la guerre actuelle ont été semés dans les années 1990, lorsque les États-Unis et leurs alliés ont décidé d'étendre l'OTAN vers l'est — malgré des promesses claires faites à Gorbatchev. Aujourd'hui, l'idée même d'une promesse de ne pas étendre l'OTAN est rejetée comme une simple invention de la propagande russe, alors que des témoignages directs suggèrent le contraire. Même des figures comme George Kennan et Henry Kissinger — qui n'étaient pas des pacifistes — avaient averti que l'OTAN aux frontières de la Russie provoquerait une réaction. Leurs avertissements ont été délibérément ignorés.
Les élites occidentales ont supposé que la Russie était trop faible ou trop divisée pour résister. Elles ont supposé que le monde de l'après-guerre froide était unipolaire, que les États-Unis et leurs alliés pouvaient façonner l'ordre mondial à leur image. Cette arrogance n'était pas seulement stratégique — elle était morale. Elle supposait que le mode de vie occidental était d'une supériorité et d'une justesse si évidentes, qu'aucun acteur rationnel ne pouvait le rejeter.
Mais le monde n'est pas une salle de séminaire. C'est un terrain d'intérêts contradictoires, de cultures divergentes et de blessures historiques. Sous la pression, des pays comme la Russie sont tout à fait disposés à se battre pour leurs intérêts sécuritaires. Imposer une vision morale unique du monde n'est pas de l'idéalisme — c'est de l'impérialisme.
Zones névralgiques, voies vitales et corridors énergétiques

L'implication géopolitique de l'Occident en Ukraine ne peut être comprise sans considérer la géographie et les ressources. L'Ukraine n'est pas seulement un pays qui se bat pour sa survie. C'est un point clé en Eurasie — un pont terrestre entre l'Europe et la Russie, un corridor énergétique important, et une zone tampon dont l'allégeance détermine l'équilibre des forces sur le continent. Pourquoi l'UE et l'OTAN voulaient-elles si désespérément l'Ukraine ? Était-ce vraiment la volonté du peuple ukrainien, comme on l'affirme couramment ? L'UE et l'OTAN n'auraient-elles pas pu simplement laisser l'Ukraine tranquille ?

Halford Mackinder, le géographe britannique, soutenait autrefois :
"Qui gouverne l'Europe de l'Est commande le Heartland ; qui commande le Heartland contrôle l'Île-Monde ; qui contrôle l'Île-Monde gouverne le monde."
Halford Mackinder
Cette théorie, longtemps écartée comme dépassée, revient en force. L'Ukraine est la porte d'entrée vers le heartland, la Russie. Et la lutte pour son contrôle ne concerne pas seulement les valeurs — elle concerne le pouvoir. Le grand personnage polonais de la politique étrangère américaine, Zbigniew Brzezinski, évoquait également la signification géopolitique de l'Ukraine :
"Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire, mais si l'Ukraine est corrompue puis dominée, la Russie devient automatiquement un empire."
Zbigniew Brzezinski
Du point de vue de la Russie, la guerre en Ukraine revêt donc un caractère existentiel.
D'autre part, la dépendance de l'Europe au gaz russe était une faiblesse que Washington voulait réduire depuis longtemps. Les pipelines Nord Stream n'étaient pas seulement des projets commerciaux — c'étaient des artères stratégiques entre l'Allemagne et la Russie. Leur sabotage — encore entouré de mystère et de silence — a éliminé la possibilité d'un rapprochement. Il a forcé l'Europe à réaligner sa politique énergétique — vers le GNL américain, à des prix considérablement plus élevés.
Ce n'était pas un accident. Cela faisait partie d'une stratégie plus large : lier l'Europe plus étroitement à l'alliance atlantique et empêcher toute diplomatie indépendante envers Moscou. Là encore, il n'était pas question de géopolitique. Il s'agissait uniquement de « sécurité énergétique ». Mais le calcul sous-jacent était de la realpolitik classique.
Les conséquences nationales des croisades morales
Tandis que les politiciens occidentaux parent leurs missions étrangères de vertu, les conséquences intérieures révèlent une autre réalité.
Les sanctions contre la Russie — sans précédent par leur ampleur — étaient censées paralyser le Kremlin et mettre fin rapidement à la guerre. Au lieu de cela, elles ont donné naissance à une nouvelle économie mondiale de plus en plus indépendante de l'Occident, ont renforcé l'autosuffisance de la Russie et approfondi la méfiance du Sud global envers le système dollar.
En Europe, les sanctions ont provoqué une désindustrialisation, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Les partis de droite et de protestation gagnent du terrain, nourris par le mécontentement face à un idéalisme qui s'est transformé en souffrance économique. Néanmoins, la classe politique refuse de changer de cap. La guerre contre la Russie semble désormais être devenue sa mission. Étonnamment, la population reste également relativement passive. Le mythe de la guerre juste et inévitable contre la Russie semble avoir plongé la population dans un état de fatalisme apocalyptique. Mais l'avenir n'est pas encore écrit ; l'histoire n'est pas le destin. Les gens pourraient théoriquement faire la différence s'ils pouvaient seulement comprendre qu'ils ont cette possibilité. Mais aujourd'hui, ils semblent trop occupés à haïr Poutine et la Russie pour le comprendre. Du point de vue de l'élite européenne, c'est un scénario presque parfait.
La reconduction stupéfiante d'Ursula von der Leyen au poste de présidente de la Commission européenne il y a un an — malgré sa position belliciste et son mépris de la démocratie — a signalé que l'Europe entend maintenir le cap. La guerre n'est plus une politique — elle fait partie de l'identité de l'Union européenne. L'UE comme projet de paix appartient au passé.
Pour une géopolitique honnête
Rien de tout cela ne signifie que la morale n'a pas sa place dans la politique internationale. Mais la morale doit être cohérente, réfléchie et guidée par la sagesse. Elle ne doit pas être un étendard sélectif ou une arme hypocrite. La seule façon de réhabiliter la morale en politique serait de la découpler de la propagande. Mais est-ce même possible ?
Cela exige un examen de conscience. L'Occident doit reconnaître qu'il est lui aussi un acteur géopolitique. Il doit admettre que ses interventions, alliances et doctrines sont façonnées non seulement par des valeurs universelles mais aussi par des intérêts stratégiques. Ce n'est qu'alors qu'il pourra commencer à s'engager avec le monde tel qu'il est — et non tel qu'il l'imagine.
L'histoire de la politique étrangère américaine a été émaillée d'opérations secrètes, de changements de régime et de manipulations — toujours au nom de la liberté. Ignorer cela est fatal. Une société fondée sur des illusions — sur son passé, son rôle dans le monde et sa pureté morale — ne peut survivre éternellement. Nous sommes peut-être aveugles à nos doubles standards, mais les autres n'ont pas à l'être, et ils n'ont aucune envie d'être dupés par nous. L'Europe s'est portée garante des accords de Minsk, mais au final, ceux-ci se sont révélés n'être rien de plus qu'une tentative de donner à l'Ukraine le temps de se réarmer. Nous prêtons peut-être peu d'attention à ces petits faits, mais d'autres en tirent la leçon que l'Occident n'est pas fiable. Il n'est pas évident qu'ils aient tort, qu'eux seuls soient paranoïaques et fous.
La tâche n'est pas d'abandonner les valeurs, mais d'affronter la réalité. De se demander si nous n'avons pas seulement raison, mais si nous atteignons nos objectifs. Si notre cause n'est pas seulement juste, mais si nos moyens sont également appropriés. Et surtout, de comprendre que dans un monde d'États souverains, la puissance compte, et que d'autres acteurs peuvent percevoir la puissance de l'Occident comme une menace. Prétendre que ce n'est pas le cas ne fait que rendre le monde plus dangereux.
Tant que cet examen de conscience n'aura pas lieu, l'Occident continuera de mener ses croisades morales. Il accusera les autres de ce qu'il fait lui-même. Et il prendra ses illusions pour la vérité — jusqu'à ce que le prix devienne trop élevé.
«Géopolitique et moralité»